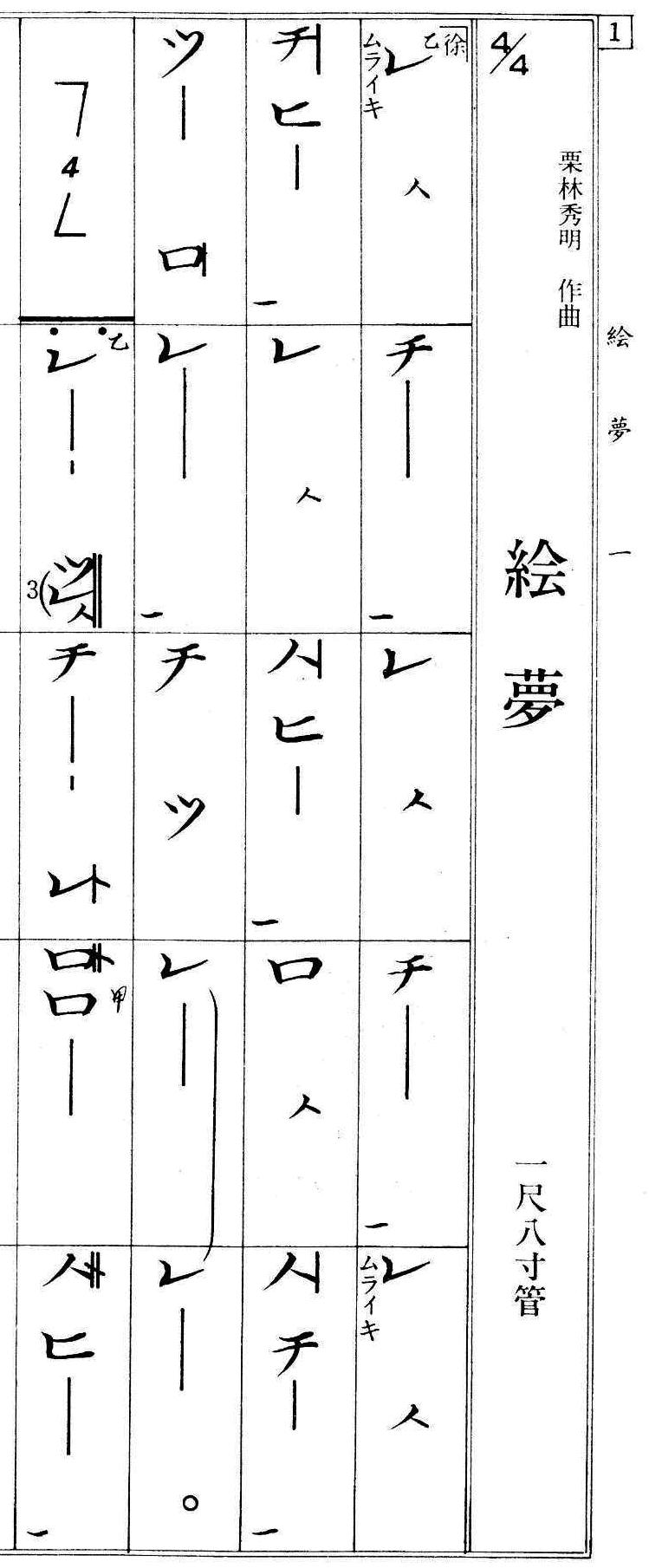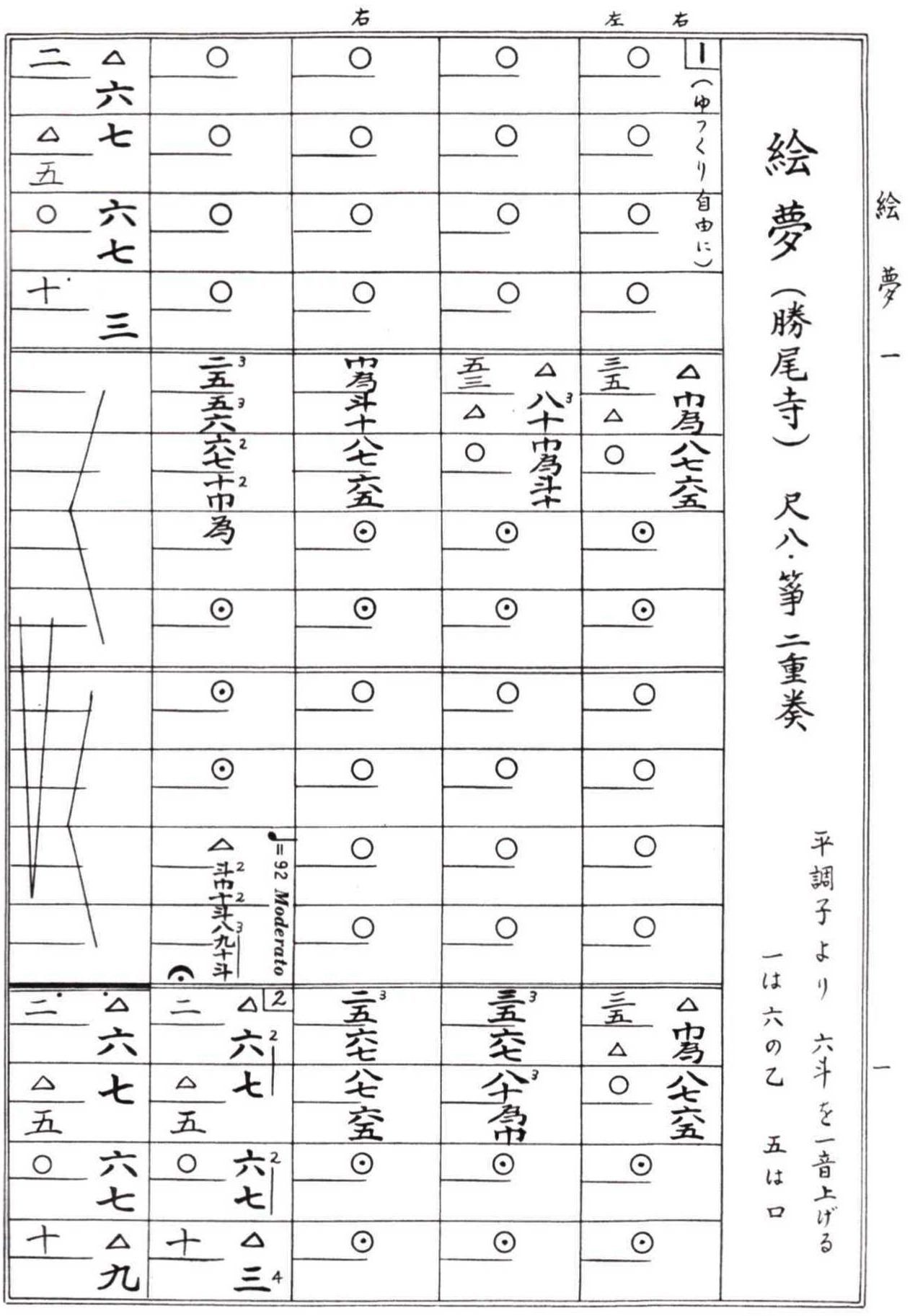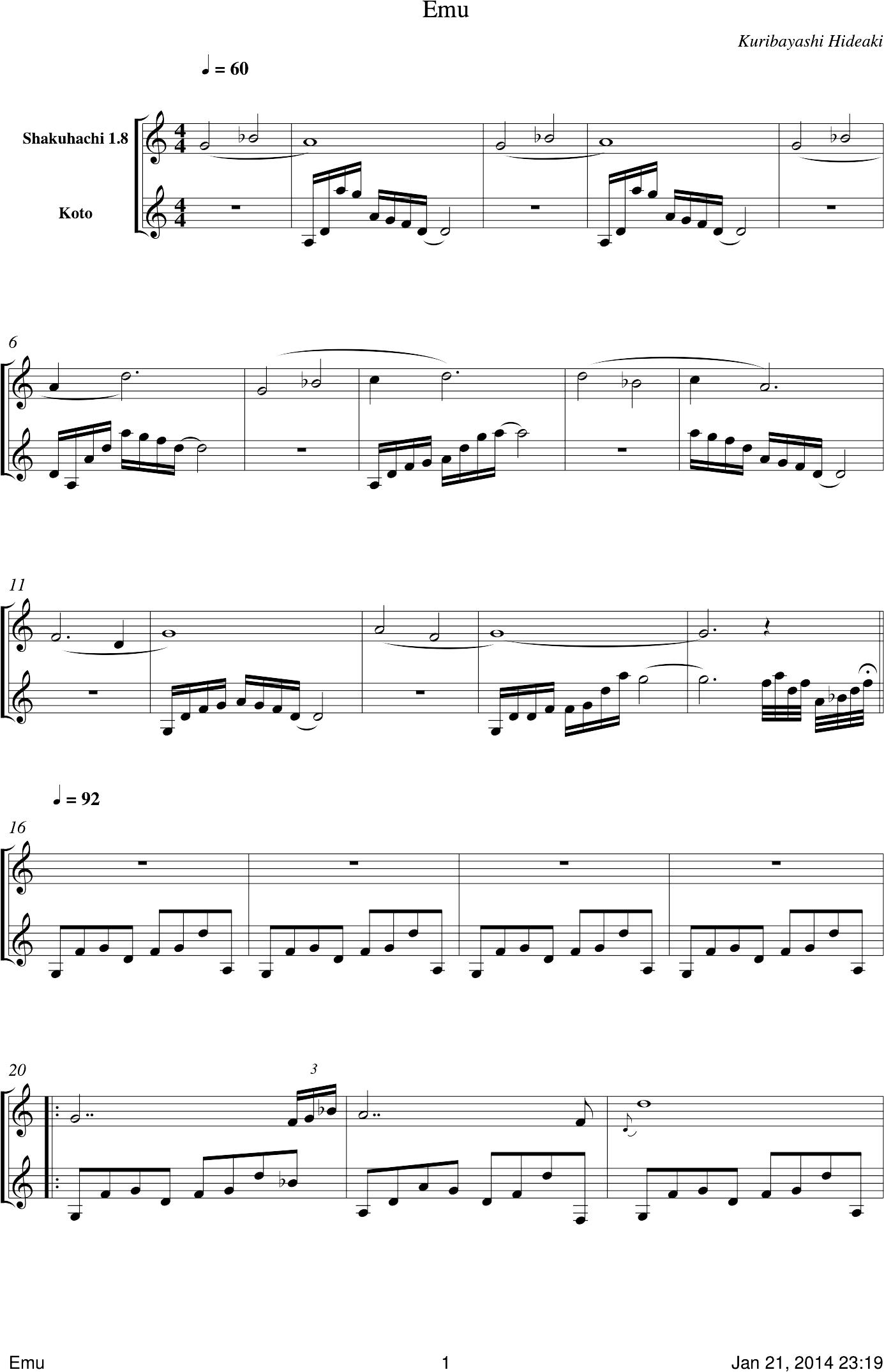Quelques éléments sur
le shakuhachi
Frédéric Boulanger
frederic.boulanger.fbo@gmail.com
Contenu en partie emprunté à :
Christophe Kazan 火山 Gaston
Sources
Source principale :
Deconstructing Tradition in Japanese Music
A study of Shakuhachi, Historical Authenticity and Transmission of Tradition

Thèse de doctorat de Gunnar Jinmei Linder
The International Shakuhachi Society : www.komuso.com
The European Shakuhachi Society : shakuhachisociety.eu
Le shakuhachi
- Flûte japonaise droite taillée dans un pied de bambou,
d'origine chinoise - Taille « standard » : 1 pied 8 pouces (一尺 八寸) ➙ 尺八
- 7 nœuds, 5 trous de jeu, perce conique inversée
- Embouchure : biseau renforcé d'une pièce en corne, ivoire ou acrylique

Origines possibles
- le ney (Asie centrale -3000 / -2000 BCE)
- le ney est peut-être l'ancêtre du chiba (尺八)
de la dynastie Tang (618 - 907) en Chine
- le chiba est probablement l'ancêtre du shakuhachi (尺八)
- traces attestées au Japon à partir du VIIIe siècle
Origines possibles

Utilisé un certain temps en ensemble
dans les orchestres de gagaku
(musique de cour)
Un peu bizarre... mais …
très moderne 😉
On le trouve sous sa forme (presque)
actuelle à partir du début du XVIe siècle,
joué par des moines mendiants (komuso)
L'âge d'or du shakuhachi est la période Edo (1603 - 1867)
Exemple de gagaku (musique de la cour impériale)
Le shō, orgue à bouche (dans un répertoire inhabituel !)
Shakuhachi et samourais
à l'époque Edo (1603 - 1868)

Portrait of Tokugawa Ieyasu by Kanō Tannyū (1602-1674) Wikimedia
Tokugawa Ieyasu (1543 - 1616)
devient shogun
Il impose la paix aux grands seigneurs
de guerre japonais
Un grand nombre de soldats (samourais) vont
perdre leur fonction auprès des seigneurs et
devenir rōnin (samourais sans maître)
Certains rōnin vont devenir des moines itinérants, joueurs de shakuhachi

Komusos : les moines de la vacuité et du néant
Grandes figures de l'histoire japonaise
Moines revendiquant une filiation bouddhiste associée à un maître chinois (possiblement légendaire) : Fuke
Ils pratiquent le shakuhachi pour méditer
Ils fondent un corpus de pièces appelées honkyoku (pièces classiques/fondamentales)

Moine Komuso par Katsukawa Shunshô (1726-1792)
Les Komusos et le
répertoire des Honkyoku
Les Komusos ont beaucoup lutté pour
faire reconnaître leur ordre comme
une secte bouddhiste
Ce statut leur a donné de grands avantages,
comme celui de se déplacer librement dans le pays
Des temples komuso leur servaient de gite d'étape
ou de lieu de vie permanent
Lors de leurs rencontres dans les temples
ou sur les routes ils partageaient oralement
des honkyoku
Exemple de honkyoku
Myoan Tamuke

Maekawa Kogetsu
Pièce utilisée aujourd'hui comme requiem
Jouée ici dans le style Myoan,
qui se revendique très proche
du style des moines komuso
Pièce à vocation religieuse suizen
(zen du souffle)
Flûte très longue, à perce large
et de facture simple (jinashi)
Kinko Kurosawa et le style Kinko

Kinko Kurosawa (1710 - 1771) traverse le Japon
Il collecte 36 honkyoku et les réarrange
Il fonde une des écoles de shakuhachi les plus influentes (Kinko Ryû)

Goro Yamaguchi (1933 – 1999)
à gauche avec son père

Banshiki Cho (musique en Si)
L'ère Meiji et le shakuhachi

L'ère Meiji débute avec la chute du gouvernement des shoguns, quand l'empereur Mutsuhito (Meiji) reprend les pleins pouvoirs
Il déplace la capitale de Kyoto à Edo, qui est renommée Tokyo
Le shintoïsme devient la religion officielle
Le bouddhisme
est considéré comme « la religion des shoguns »
Comme d’autres bouddhistes, les komuso vont être opprimés
et leur ordre interdit
L'ère Meiji et le shakuhachi
Pour les anciens komuso, l’enjeu est alors de trouver un moyen
de sauver la pratique des honkyoku.
Deux Komusos, Araki Kodō II et Yoshida Itchō, vont réussir
à convaincre le gouvernement de Meiji que le shakuhachi
avait des racines musicales japonaises plus anciennes
et sans aucun lien avec le bouddhisme.
Ils obtiennent que la pratique de l’instrument continue,
officiellement uniquement avec le koto et le shamisen,
ainsi que pour la musique populaire.
Les honkyokus continueront à être transmis secrètement
De l'ère Meiji au XXIe siècle
Courant Meiji, les écoles de shakuhachi vont se structurer (Ryu)
autour du système de Iemoto (dynasties familiales dirigeant des écoles)
La pratique du shakuhachi va être de plus en plus intriquée
avec celles du koto et du shamisen
Le Japon se met à interagir avec le reste du monde
et la musique traditionnelle en est influencée
Nakao Tozan et le style Tozan


Nakao Tozan (1876 - 1956)
est une figure
centrale du début du XXe siècle
Il va se détacher des répertoires anciens pour reconstruire un nouveau répertoire
Il est le premier à écrire des pièces pour ensemble de shakuhachi.
Il est influencé par la musique occidentale tout en étant profondément ancré dans la musique traditionnelle japonaise
Kangetsu (la lune froide), trio final
Hozan Yamamoto : shakuhachi et jazz, variété, musique contemporaine
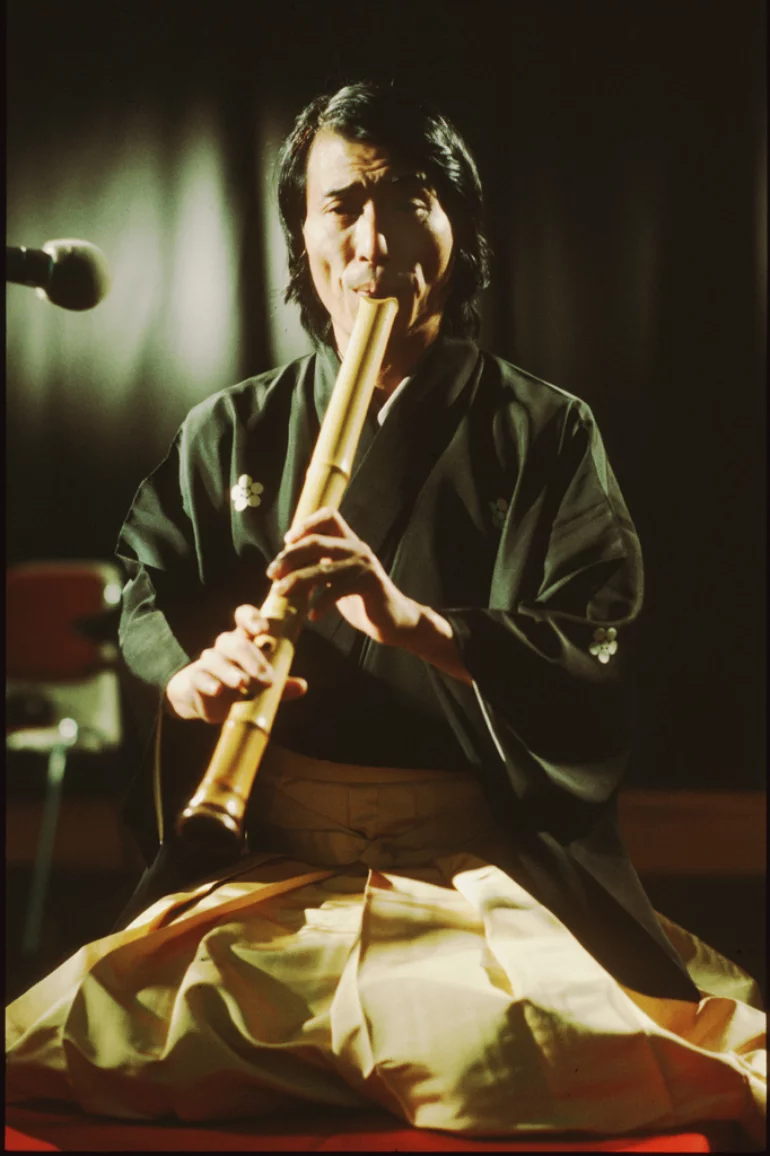

Fin XXe, début XXIe, le shakuhachi rencontre le jazz, la variété, la musique contemporaine etc.
Hozan Yamamoto est une figure illustre
de ce mouvement
Encounter, de Hozan Yamamoto
Le sankyoku (musique à trois) 三曲
Dénomination générique qui regroupe la musique pour shamisen, koto et shakuhachi :
- le Jiuta (地歌 répertoire du shamisen, Koide Ichijuro 1740 – 1800, Kurokami)
- le Sōkyoku (箏曲 répertoire du koto, Yatsuhashi Kengyo 1614 - 1685, Rokudan)
- le Shinkyoku (新曲 répertoire du début du XXe siècle, Michio Miyagi 1894 – 1956, Haru no Umi)

Mieko Miyazaki, koto
Suizan Lagrost, shakuhachi
Festival Arkhé – Bussigny – 16/03/2024
Chidori no Kyoku, Mieko Miyazaki, Suizan Lagrost
Haru no Umi, Mieko Miyazaki, Suizan Lagrost
Différentes notations
pour le shakuhachi
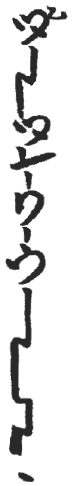


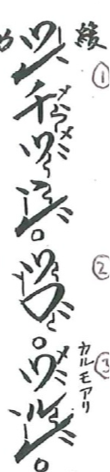
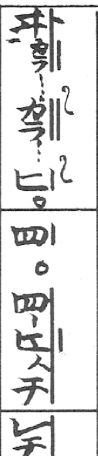
Hon Shirabe
Honkyoku
Koden Sugomori
Honkyoku
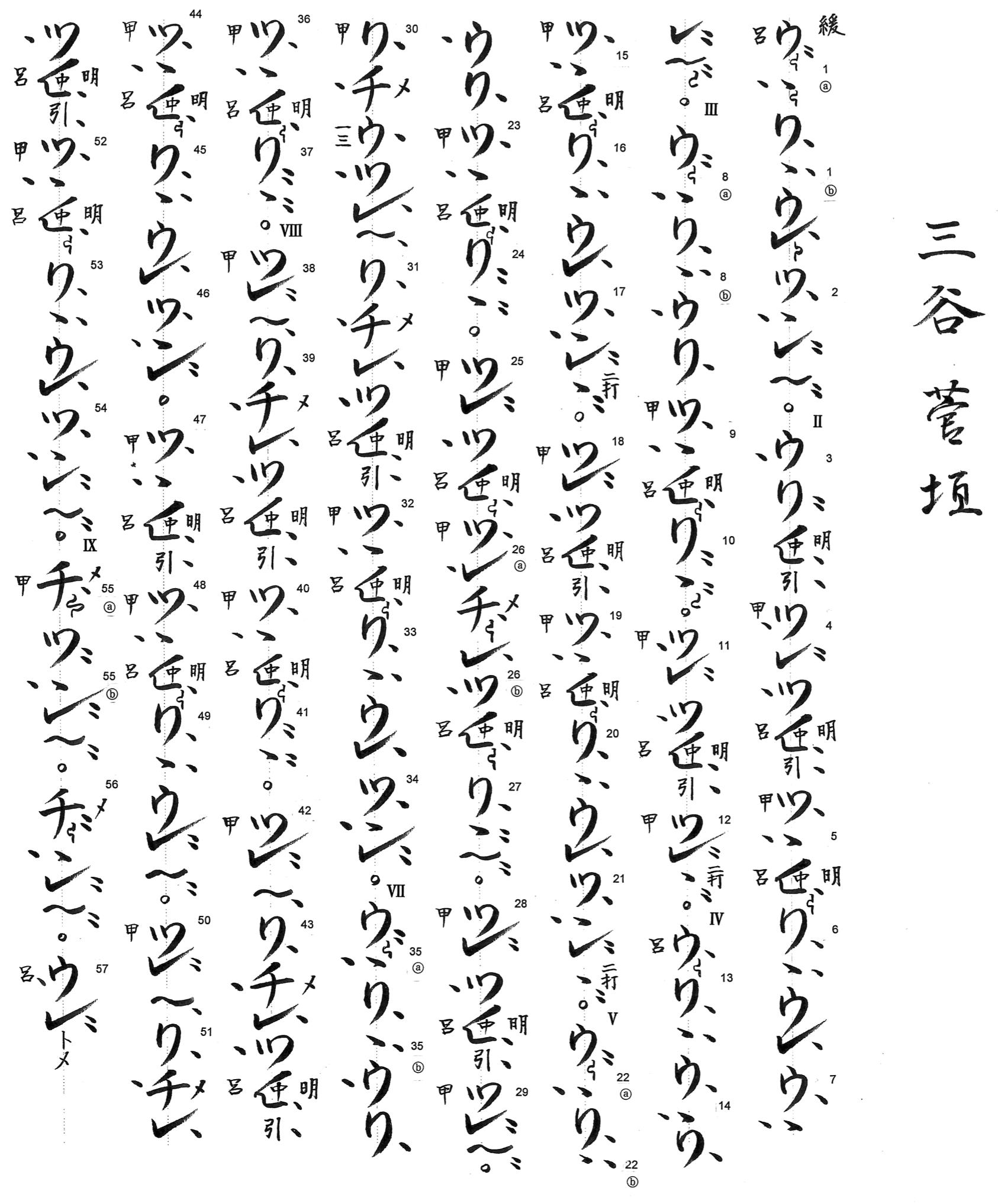
Sanya Sugagaki
Honkyoku,
version Chikumeisha (Goro Yamaguchi)
Asa Kaze
Honkyoku Tozan
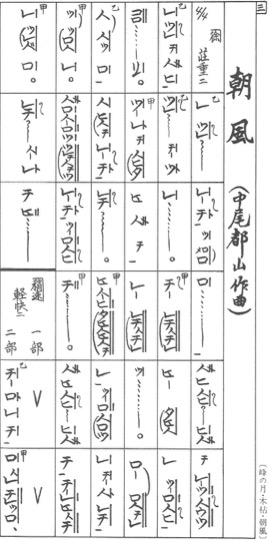
Tozan Gakkai
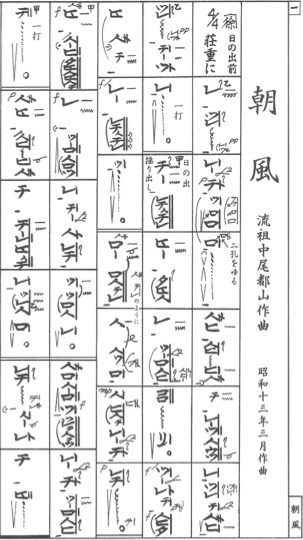
Emu (image d'un rêve)